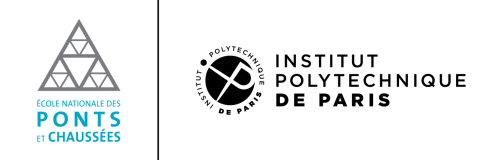Thèse
Thèse début en octobre 2021 sous la direction d’Olivier Coutard
Ce travail de recherche observe l’émergence de dispositifs publics de compensation carbone à l’échelle nationale et locale en France au tournant des années 2020. Un ensemble d’acteurs produisent des cadres de certification, vendent et achètent des certificats carbone dans le secteur agricole et sylvicole qui doivent permettre d’engendrer des processus de réductions d’émissions ou de séquestration de dioxyde de carbone dans la biomasse. Cette enquête cherche à comprendre avec quels acteurs et quels moyens sont construits ces dispositifs, dans un contexte où ce type d’instrument fait l’objet de controverses depuis le milieu des années 2000. Ce travail s’appuie sur une méthode qualitative, avec quarante-sept entretiens semi-directifs, vingt-cinq réunions observées (observation participante) et la visite de huit sites de projets. L’enquête s’est construite à partir d’un jeu d’hypothèses éprouvé auprès des enquêtés qui ont été sélectionnées pour représenter le spectre des acteurs impliqués dans ces dispositifs : services administratifs de l’Etat et des collectivités, élus locaux, intermédiaires (techniques, administratifs et financiers), entreprises, agriculteurs et propriétaires forestiers. L’intrication d’enjeux de quantification, de certification et de valuation économique en situation de controverse et d’incertitudes en fait un objet de recherche transversal. Mobilisant des outils à l’interface entre la sociologie de l’action publique, la sociologie de la quantification et la sociologie du marketing environnemental, l’enquête discute les arbitrages de forums techniques impliquant acteurs publics et privés autour de la quantification du CO2e et de la biodiversité, la certification et la mise en marché. Cette thèse examine plusieurs dimensions par lesquels ces acteurs cherchent à recrédibiliser un instrument contesté : l’argument de la coconstruction (chapitre 1), l’argument de la précision des quantifications et de la prise en compte quantitative des incertitudes (seuils, rabais) dans le référentiel général et les méthodologies sectorielles (chapitre 2), l’argument de la moralisation des pratiques par la mise en place de chartes de valeurs (chapitre 3) et enfin l’outil du renouvellement sémantique (chapitre 4).
Articles
Collectif Non-Établi. (à paraitre). “Are you ready for dessert ? Remaking scientific conviviality”. Journal of Environnemental Media : Care-ful convening: towards low carbon and inclusive knowledge sharing (6.2).
Enseignements
2025-2026 – Ecole d’Urbanisme de Paris, Master 1, Enjeux environnementaux contemporaines (6h)
2024-2025 – Ecole d’Urbanisme de Paris, Master 1, Enjeux environnementaux contemporaines (6h)
2023-2024 – Ecole d’Urbanisme de Paris, Master 1, Enjeux environnementaux contemporaines (16h)
2023-2024 – Ecole d’Urbanisme de Paris, Master 2, Séminaire méthodologique (6h)
Colloques, séminaires
2024 – Journées de la Recherche en Sciences Sociales (JRSS), “La coopérative carbone de La Rochelle, une viabilité économique en tension.”
2023 – Institut Francilien Recherche Innovation Société (IFRIS), Ecole Thématique, “Neutralité carbone d’une grande entreprise : la compensation carbone pour suppléer les limites de l’action climatique privée ?”
2022 – Institut Francilien Recherche Innovation Société (IFRIS), Ecole Thématique, “Compensation carbone locale forestière en France : le rôle du facteur temporel dans les arbitrages sociotechnique entre impératifs de gouvernement.”
Médias
2021 – France Culture, La Méthode Scientifique, “Compensation carbone : l’arbre qui cache la forêt ?”